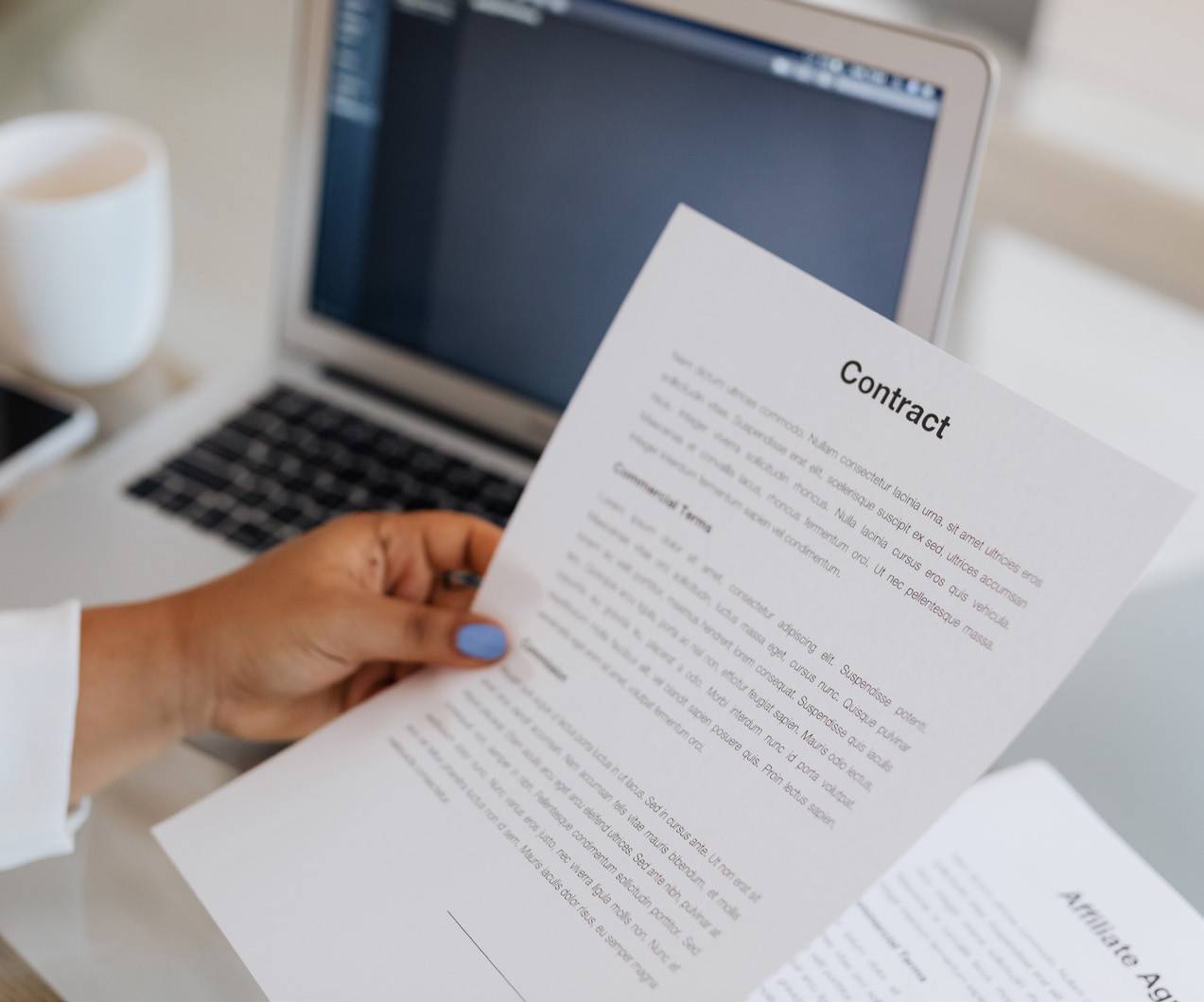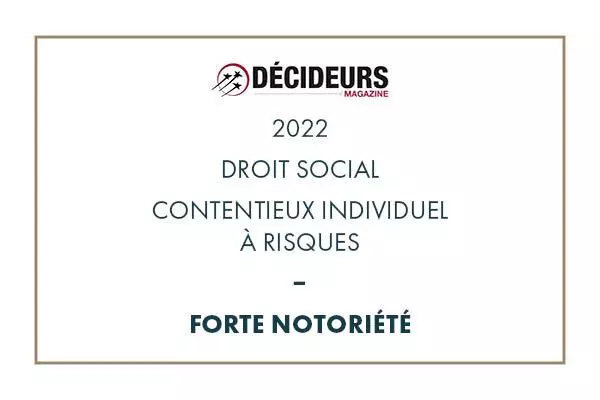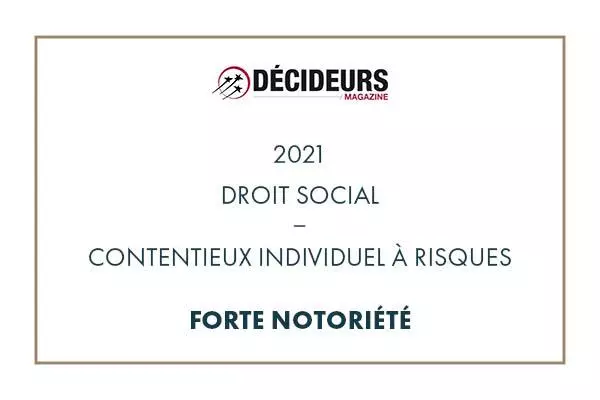Harcèlement moral Institutionnel
5 mars 2025
« LE HARCELEMENT MORAL INSTITUTIONNEL » : UNE JURISPRUDENCE HISTORIQUE MAIS AVEC QUELLES LIMITES ? (CASS. CRIM. 21 JANVIER 2025, N° 22-87145 FSBR)
La Cour de cassation a rendu une décision majeure en reconnaissant – pour la première fois – la notion de « harcèlement moral institutionnel » dans l’affaire France Telecom. Cette décision met un terme à une affaire emblématique qui a marqué plus de 15 ans de débats publics et judiciaires.
Par cet arrêt, la Cour de cassation consacre la responsabilité pénale des dirigeants pour des pratiques managériales systématiques ayant délibérément conduit à la dégradation des conditions de travail des salariés.
* *
*
- RAPPEL DES FAITS : UNE POLITIQUE MANAGERIALE JUGEE DELIBEREMENT ANXIOGENE
L’affaire remonte à 2009, lorsqu’un syndicat dépose plainte pour harcèlement moral contre France Telecom et plusieurs de ses dirigeants.
En cause : la mise en œuvre des plans NExT (Nouvelle Expérience des Télécoms) et ACT (Anticipation et Compétences pour la Transformation), visant la suppression de 22.000 postes au sein de l’entreprise.
Cette réduction des effectifs s’accompagnait de méthodes de gestion jugées brutales : réorganisations incessantes, mobilités forcées, pressions psychologiques, surcharge de travail, et isolement des salariés.
Les prévenus, dont le PDG et le Directeur des opérations France ont été poursuivis pour harcèlement moral, en raison de leur implication dans la mise en place d’une politique d’entreprise délibérément anxiogène.
Les pratiques incluaient des incitations répétées au départ, des mobilités géographiques et fonctionnelles forcées, un management par la peur, des réductions de rémunération, des objectifs inatteignables, ainsi que des techniques de déstabilisation psychologique visant à fragiliser les salariés.
D’autres responsables, notamment des membres du service des ressources humaines, ont également été poursuivis pour complicité. Il leur était reproché d’avoir activement contribué à la mise en œuvre de ces pratiques, en organisant un suivi strict de la réduction des effectifs et en instaurant des mécanismes de pression pour favoriser les départs des salariés.
Les prévenus ont été condamnés successivement par le Tribunal correctionnel le 20 décembre 2019, puis par la Cour d’appel de Paris le 30 septembre 2022.
A ce titre, la Cour d’appel a jugé au visa de l’article 222-33-2 du Code pénal (applicable au moment des faits) qu’ils s’étaient rendus coupables de « harcèlement moral institutionnel », défini comme des
« agissements structurant une politique d’entreprise visant à organiser le travail d’un collectif de salariés, dont la répétition, de manière latente ou manifeste, entraîne une dégradation des conditions de travail, au-delà des prérogatives normales de la direction ».
Face à cette condamnation, les prévenus ont formé un pourvoi en cassation, contestant l’application de l’article 222-33-2 du Code pénal, en se fondant sur deux principaux arguments :
- Tout d’abord, ils ont fait valoir que le harcèlement moral ne peut être caractérisé que dans des relations interpersonnelles entre l’auteur des agissements et une ou plusieurs personnes clairement identifiées. Par conséquent, selon eux, le harcèlement moral ne pourrait découler de la mise en œuvre d’une politique d’entreprise ;
- Ensuite, ils affirment que le Code pénal ne prévoit pas de sanction spécifique pour le « harcèlement moral institutionnel » : étant précisé que la loi pénale doit être interprétée de manière stricte, ils estiment qu’ils ne peuvent être condamnés pour des faits qui ne sont pas expressément visés par ledit Code.
Sur ce dernier point, les prévenus ont invoqué le principe de légalité des délits et des peines, qui impose une interprétation stricte de la loi pénale, conformément aux articles 111-4 du Code pénal et 7 de la Convention européenne des droits de l’homme. Ils ont soutenu que la cour d’appel avait méconnu ces principes en étendant de manière excessive l’application de l’article 222-33-2 du Code pénal pour justifier leur condamnation au titre du « harcèlement moral institutionnel. »
Ainsi, la question soumise à la Cour de cassation portait sur la possibilité d’inclure le « harcèlement moral institutionnel » dans le champ d’application de l’article 222-33-2 du Code pénal, et qui définit les contours du harcèlement moral en milieu professionnel.
- UNE INNOVATION PRETORIENNE : LA CONSECRATION DU « HARCELEMENT MORAL INSTITUTIONNEL »
La Haute juridiction a rejeté l’argumentation des prévenus, confirmant définitivement l’arrêt d’appel. Elle a non seulement validé que « le harcèlement moral institutionnel » relève bien de cet article, mais a également précisé les critères permettant de caractériser ce délit.
Au cas particulier, la Cour de cassation définit avec précision le harcèlement moral institutionnel qui se caractérise par des :
« agissements visant à arrêter et mettre en œuvre, en connaissance de cause, une politique d’entreprise qui a pour objet de dégrader les conditions de travail de tout ou partie des salariés aux fins de parvenir à une réduction des effectifs ou d’atteindre tout autre objectif, qu’il soit managérial, économique ou financier, ou qui a pour effet une telle dégradation, susceptible de porter atteinte aux droits et à la dignité de ces salariés d’altérer leur santé physique ou mentale, ou de compromettre leur avenir professionnel ».
S’agissant de l’élément intentionnel, la Cour de cassation a confirmé la décision des juges du fond en considérant que des « agissements délibérés » visant à dégrader les conditions de travail, même sans lien direct entre les dirigeants et les salariés affectés, suffit à caractériser l’intention de nuire.
S’agissant de l’élément matériel, la Cour de cassation considère qu’il n’est pas nécessaire d’identifier des victimes précises : une politique d’entreprise ayant pour « objet ou pour effet » de compromettre la santé mentale des salariés suffit à caractériser l’infraction.
En outre, elle précise que le terme « autrui », visé à l’article 222-33-2 du Code pénal, peut désigner un collectif de salariés non identifiés individuellement. Cette interprétation s’appuie sur les travaux préparatoires de la loi de modernisation sociale de 2002 et sur des avis du Conseil économique et social, qui avaient déjà identifié le harcèlement institutionnel comme une stratégie de gestion abusive.
Ainsi, la décision de la Cour de cassation élargit la portée de l’article 222-33-2 du Code pénal.
Plus précisément, il n’est plus nécessaire d’identifier des victimes précises : le harcèlement moral peut désormais être reconnu à l’échelle collective. Cela signifie qu’une politique d’entreprise, même sans interaction directe entre les dirigeants et les salariés concernés, peut constituer une infraction si elle a pour « objet » ou « effet » de dégrader les conditions de travail.
- UN PRECEDENT NON NEGLIGEABLE POUR LES EMPLOYEURS
Cet arrêt constitue un précédent majeur, posant les bases d’une jurisprudence susceptible de s’étendre à d’autres affaires similaires, avec des conséquences importantes sur la responsabilité des dirigeants ainsi que de la direction des ressources Humaines.
Le « harcèlement moral institutionnel » est désormais un concept juridique pleinement reconnu, appelé à influencer durablement le paysage judiciaire français. Il s’inscrit dans une volonté de prévention des risques psychosociaux en entreprise.
Il est donc indispensable que la direction de l’entreprise soient bien informés des enjeux liés aux choix stratégiques organisationnels ou des projets de restructuration au sein de l’entreprise qui seraient susceptibles d’entraîner des répercussions sur les salariés.
En définitive, le harcèlement moral institutionnel ouvre la voie à une réflexion plus large sur la responsabilité des entreprises en matière de bien-être au travail, imposant une vigilance accrue sur les pratiques de gestion des ressources humaines et la nécessité d’un encadrement des politiques managériales.